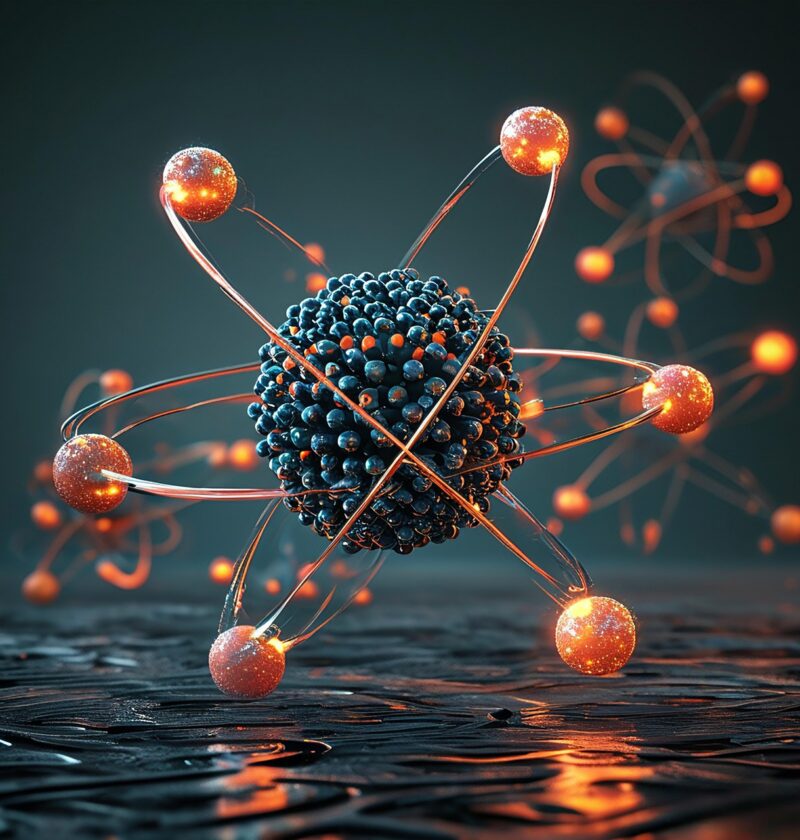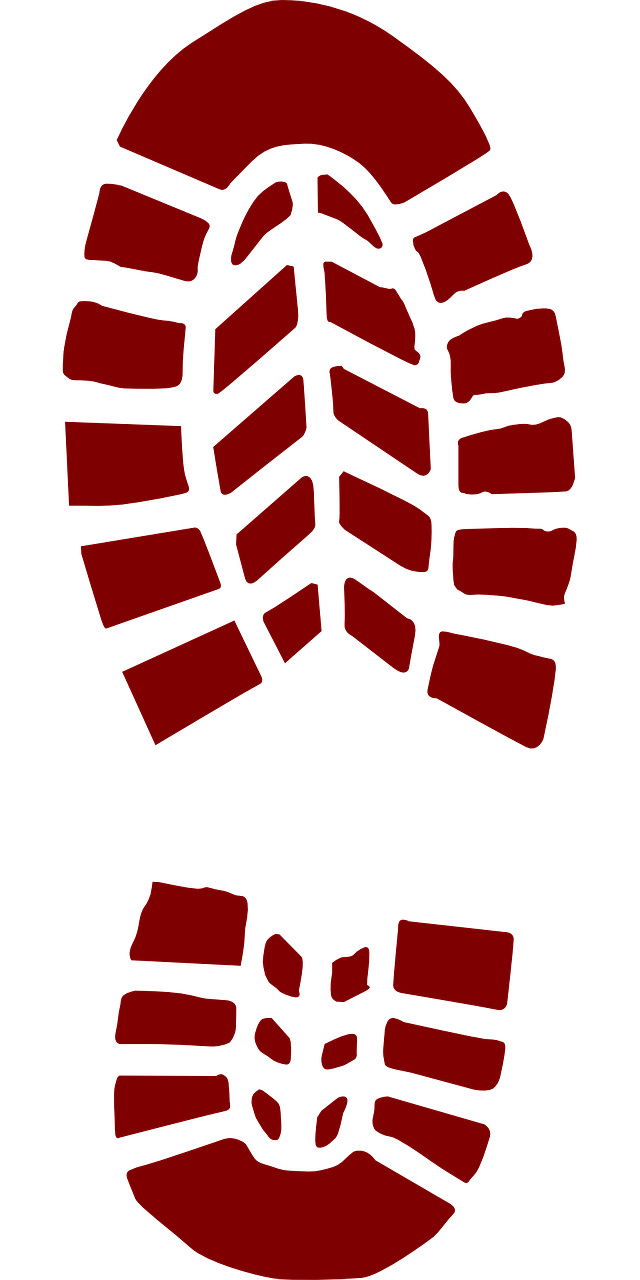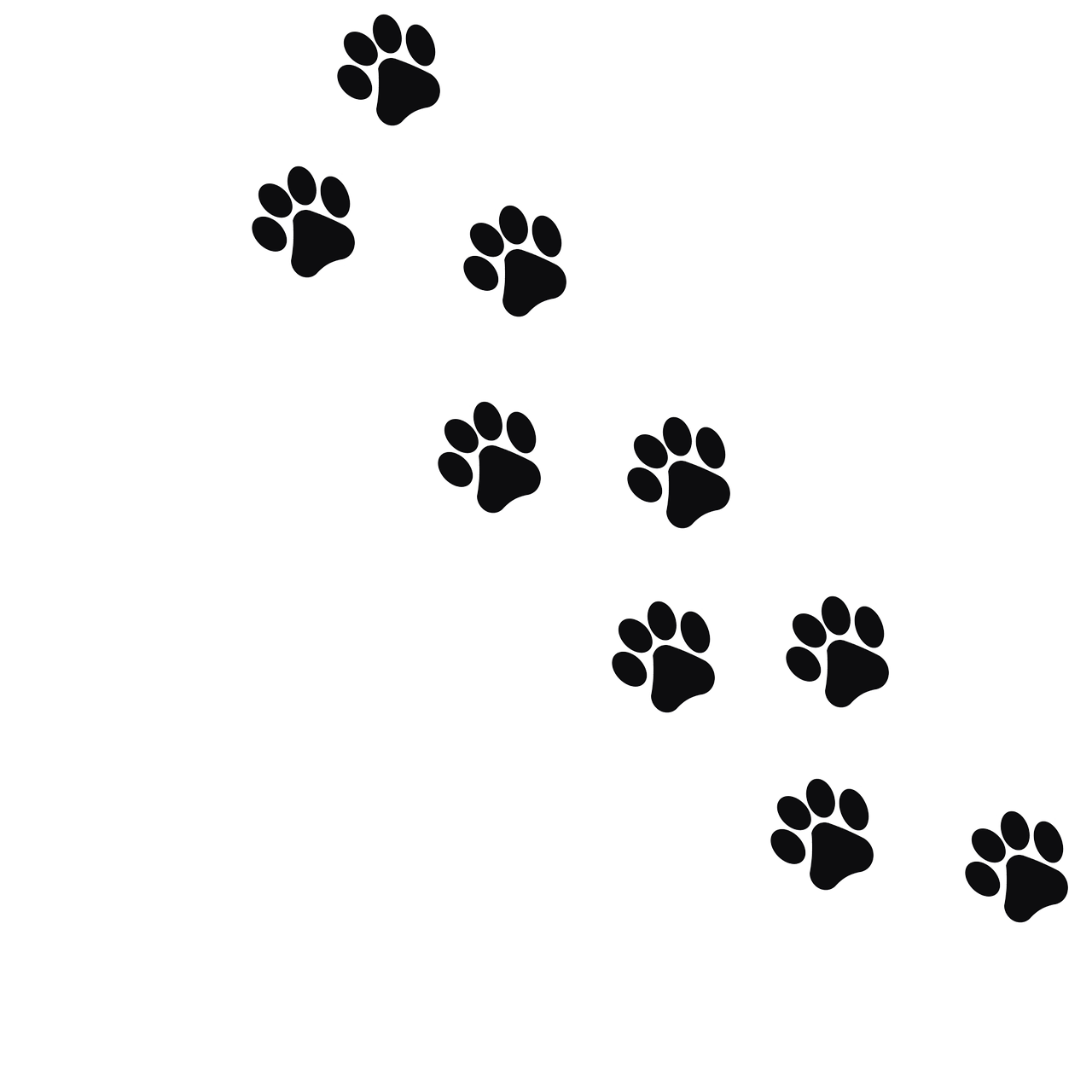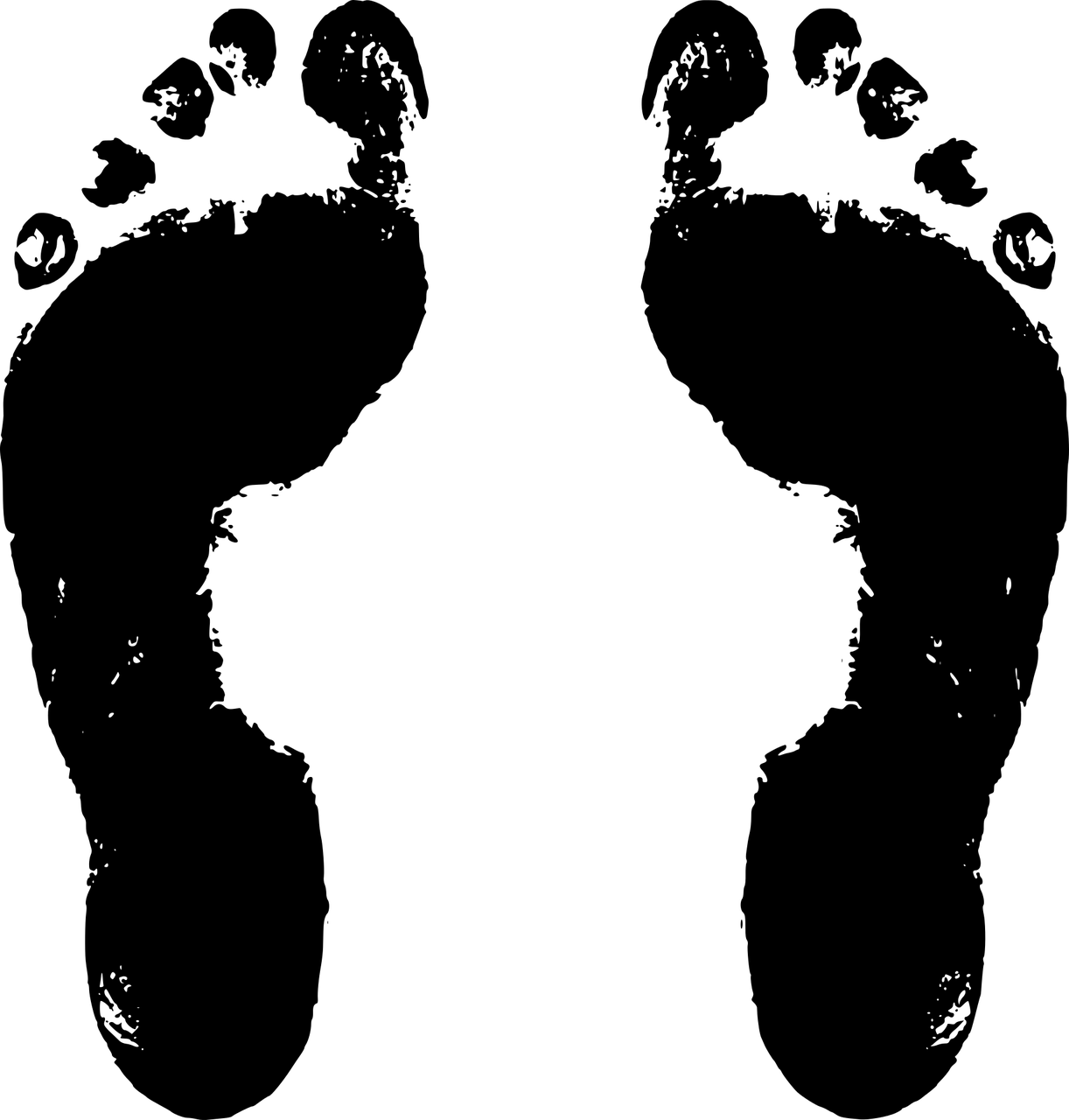|
EN BREF
|
La première étude sur l’empreinte carbone du secteur de la création artistique, présentée par le ministère de la Culture le 7 juillet 2025, révèle que ce secteur contribue à 1,3% des émissions de CO² en France. L’analyse, effectuée par le cabinet PwC, fournit des données essentielles sur l’impact environnemental des pratiques artistiques.
Les émissions de gaz à effet de serre estimées à 400 kilotonnes de CO²e par an pour la création artistique subventionnée soulignent la nécessité d’actions ciblées. Le rapport met l’accent sur la mobilité des spectateurs et des achats de biens et services comme principaux postes d’émission, notamment dans les domaines du spectacle vivant et des arts visuels.
À travers cette étude pionnière, le ministère vise à identifier des leviers de réduction de l’empreinte carbone et à adapter des politiques publiques pour une transformation écologique du secteur artistique.
Le bilan carbone de la création artistique en France est un sujet qui prend de plus en plus d’importance à mesure que les enjeux environnementaux deviennent urgents. Le ministère de la Culture a récemment publié une étude pionnière qui révèle que ce secteur contribue à hauteur de 1,3% des émissions totales de CO2 dans le pays. Cette analyse, effectuée par le cabinet PwC, s’est concentrée sur l’évaluation des gaz à effet de serre (GES) générés par les diverses pratiques artistiques. Les résultats témoignent de l’impact considérable du secteur sur l’environnement, tout en offrant des marges de manœuvre pour améliorer sa durabilité. Au-delà des chiffres, cette étude soulève des questions cruciales sur la manière dont les artistes et les institutions peuvent agir pour minimiser leur empreinte écologique.
Une initiative portée par le ministère de la Culture
L’étude sur l’empreinte carbone de la création artistique a vu le jour grâce à l’engagement du ministère de la Culture. Avec l’objectif de comprendre et de réduire l’impact écologique du secteur, la direction générale de la création artistique a dirigé cette initiative. Elle a été réalisée en collaboration avec le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS-DOC). Cette recherche a permis de réunir des données cruciales sur les pratiques individuelles et collectives des acteurs du secteur.
Une évaluation basée sur des données concrètes
Pour évaluer l’impact environnemental de la création artistique, l’étude s’est appuyée sur une méthode rigoureuse qui croise plusieurs ensembles de données. Ces informations ont été recueillies grâce à une démarche de référentiels carbone visant à accompagner les structures subventionnées par la direction générale de la création artistique (DGCA). Plus de 100 bilans carbone ont ainsi été réalisés, illustrant l’importance de la collaboration entre professionnels du secteur.
La méthodologie adoptée
La méthodologie utilisée pour cette évaluation impliquait la participation de professionnels issus de différents domaines artistiques, allant des théâtres et festivals aux galeries et institutions d’enseignement supérieur. Cela a permis de réaliser un portrait représentatif des émissions de GES causées par la création artistique. Des efforts spécifiques ont été consacrés à la formation des équipes sur les enjeux énergie-climat, ainsi qu’à la mise en œuvre de pratiques durables à travers des actions concrètes.
Les résultats préliminaires et leurs implications
Les résultats de l’étude dévoilent que les émissions de GES associées à la création artistique subventionnée atteignent environ 400 kilotonnes de CO2e par an. Ce chiffre représente environ 5% des émissions totales du secteur de la création, qui inclut également le spectacle vivant, les arts visuels et l’enseignement supérieur. En extrapolant ces résultats, il a été estimé que l’ensemble du secteur contribue à environ 8,5 millions de tonnes de CO2e, ce qui correspond à 1,3% du total des émissions de la France.
Comparaison avec d’autres secteurs
Ce bilan carbone est particulièrement révélateur lorsqu’on le compare à d’autres secteurs tels que les galeries d’art, qui représentent 254 kilotonnes, et les festivals de musique, avec 422 kilotonnes. Ces chiffres mettent en lumière la nécessité pour le secteur de la création artistique de prendre conscience de son empreinte carbone et d’adopter des stratégies visant à réduire les émissions de GES.
Des initiatives visant à réduire l’impact
Des actions concrètes commencent à émerger, comme celle du collectif 17h25, qui regroupe plusieurs institutions, dont le Théâtre du Châtelet et l’Opéra de Paris. Ils travaillent activement à la standardisation des châssis de décors afin de limiter le transport lors des tournées, une étape cruciale pour réduire les émissions liées à la logistique.
Focus sur le spectacle vivant et les arts visuels
L’étude a permis de différencier les secteurs du spectacle vivant et des arts visuels en ce qui concerne leur empreinte carbone. Les résultats indiquent que pour le spectacle vivant, la mobilité des spectateurs est le principal poste d’émission, représentant 38% des émissions totales. En matière d’arts visuels, la mobilité des visiteurs représente à elle seule 65% des émissions, ce qui confirme que le transport est un facteur clé dans l’empreinte carbone du secteur.
Les postes d’émissions spécifiques au spectacle vivant
Outre la mobilité des spectateurs, les achats de biens et services, incluant les décors et les costumes, représentent également une part significative des émissions, atteignant 25%. De plus, la part des achats amortissables, tels que les véhicules et équipements, contribue à hauteur de 10% des émissions. Cette répartition souligne l’importance de repenser ces pratiques pour aller vers une écoconception et une réduction des achats liés aux spectacles.
Les défis à relever dans les arts visuels
Dans le cadre des arts visuels, bien que la mobilité des visiteurs soit prédominante, les achats de biens et services constituent toujours une part non négligeable des émissions, s’élevant à 19%. Cela met en lumière l’importance de solutions réutilisables et circulaires, où les productions en fin de vie peuvent être valorisées, une initiative largement encouragée par des structures comme le RESSAC.
Les perspectives d’avenir
La synthèse des résultats de l’étude a été présentée lors du Festival d’Avignon le 7 juillet 2025, suscitant des discussions autour des prochaines étapes à envisager pour minimiser l’empreinte carbone du secteur. Les résultats détaillés concernant les arts visuels et l’enseignement supérieur de la création seront dévoilés à la rentrée 2025. L’ensemble de l’étude sera mis à la disposition du public sur le site du ministère de la Culture à l’automne 2025.
Intégration dans les politiques publiques
Les résultats obtenus seront intégrés dans la 3e Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), visant à identifier les leviers de réduction de l’empreinte carbone au niveau national. Cela permettra d’inscrire la création artistique dans une démarche de neutralité carbone, en vue des objectifs européens fixés pour 2050. Les résultats serviront également à affiner les politiques publiques axées sur la transformation écologique de la création artistique.
Un appel à l’action collective
Cette étude représente un tournant majeur pour le secteur car elle appelle à une action collective. À l’heure où l’urgence climatique est reconnue par tous, il est essentiel que les artistes, les institutions et les différents acteurs collaborent pour établir des pratiques plus durables. La création artistique ne peut plus se concevoir sans prendre en compte son impact environnemental.
Les retombées de l’étude et ses limites
Bien que l’étude offre des insights précieux, elle n’est pas exempte de limitations. Le champ d’analyse se concentre principalement sur les structures subventionnées, ce qui pourrait créer un biais dans la représentation de l’ensemble du secteur. En outre, il est nécessaire de prendre en compte que la mesure de l’impact environnemental est complexe et que des méthodes standardisées doivent être continuellement améliorées pour tenir rodédi compte des évolutions des pratiques artistiques.
Vers des initiatives innovantes
Des initiatives innovantes émergent déjà, notamment des projets de ferroutage pour limiter l’impact des transports sur l’empreinte carbone des spectacles. Par exemple, lors du Festival d’Avignon, certains décors seront acheminés par train, une démarche qui représente une véritable avancée dans les efforts d’écoresponsabilité du secteur. Cela souligne que les artistes et les institutions prennent progressivement conscience de l’importance de réduire leur empreinte écologique.
Le rôle indispensable des artistes
Les artistes, en tant que pourvoyeurs de culture et de sens, jouent un rôle fondamental dans la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux. Leur engagement dans des pratiques plus durables peut inspirer un changement à grande échelle. La création artistique doit devenir un moyen d’éveiller les consciences sur la nécessité de préserver notre planète plutôt qu’un facteur d’aggravation des crises écologiques.
La première analyse du bilan carbone associé à la création artistique révèle un besoin urgent d’action et de collaboration au sein du secteur. Les chiffres sont alarmants, mais ils offrent également des pistes d’intervention. Il est impératif de poursuivre le travail amorcé par cette étude et de sensibiliser encore davantage les acteurs de la création artistique à l’importance d’une approche durable. Leur créativité et leur influence peuvent transformer le paysage artistique comme un vecteur de changement positif vers un avenir plus respectueux de l’environnement.

Témoignages sur l’analyse du bilan carbone associé à la création artistique
Les résultats de la première étude sur l’empreinte carbone du secteur de la création artistique sont révélateurs et soulèvent de nombreuses réactions au sein des professionnels de ce domaine. Un directeur artistique, impliqué dans la création de spectacles, a déclaré : « Il est crucial de prendre conscience de notre impact environnemental. Cette étude met en lumière des chiffres que nous ne pouvons plus ignorer. »
Une productrice de festival a ajouté : « En tant qu’organisateurs, nous devons repenser nos pratiques. L’empreinte carbone de nos événements est significative. Cette enquête nous pousse à trouver des solutions durables pour minimiser cette impact. »
Un artiste visuel a partagé son inquiétude : « Je suis souvent en déplacement pour mes expositions, et je réalise maintenant que mes choix ont des conséquences. Cette étude est un appel à agir et à adopter des méthodes de travail plus écologiques. »
De son côté, une scénographe a souligné l’importance de réfléchir à la durabilité des matériaux utilisés : « Lors de la conception de décors, il est impératif de considérer l’écoconception. J’espère que cette étude encouragera un changement de mentalité au sein de notre secteur. »
Enfin, un membre d’une association professionnelle a ajouté : « Le poids des 8,5 millions de tonnes de CO2e par an évoqué dans ce rapport est frappant. Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour réduire notre empreinte et promouvoir des pratiques artistiques responsables. »