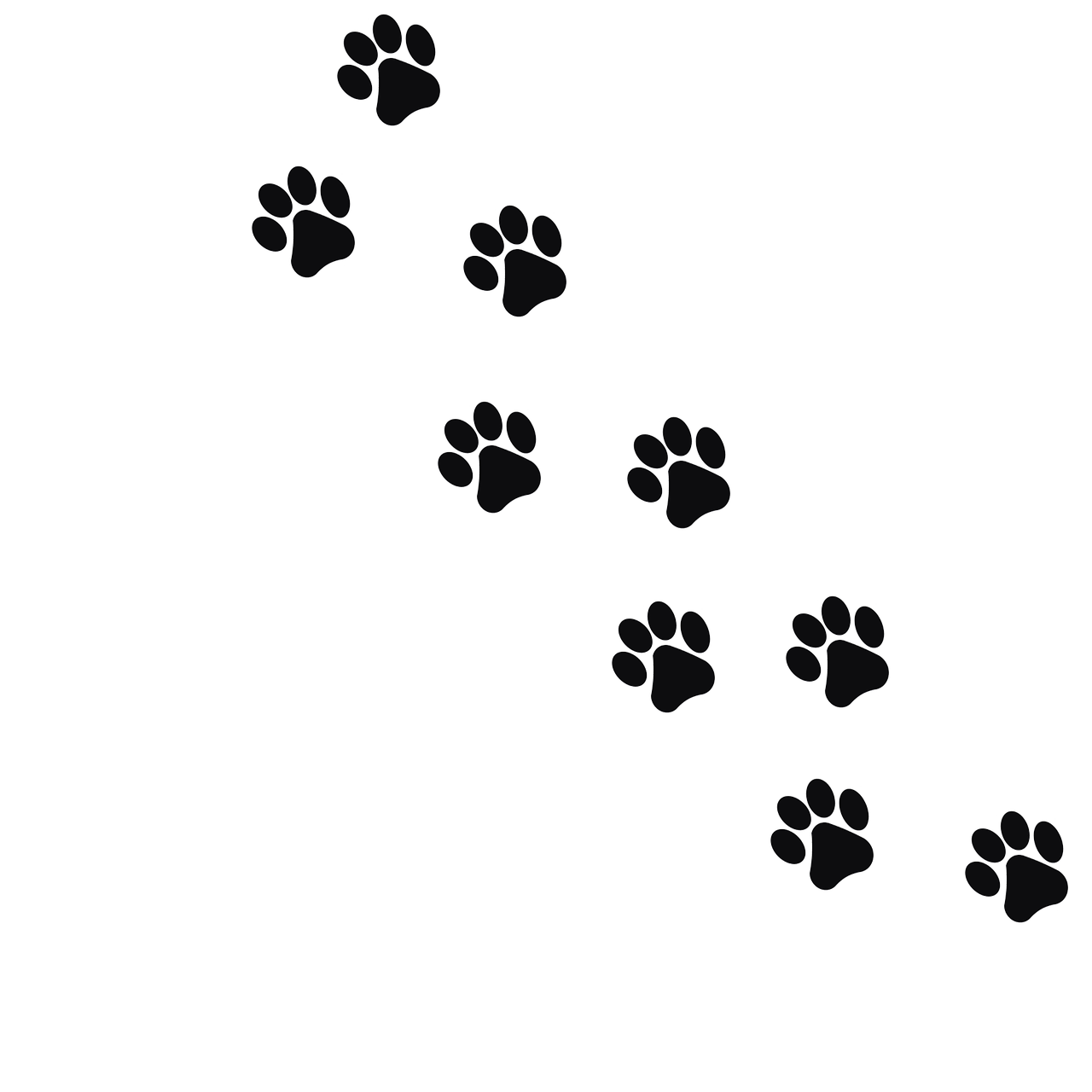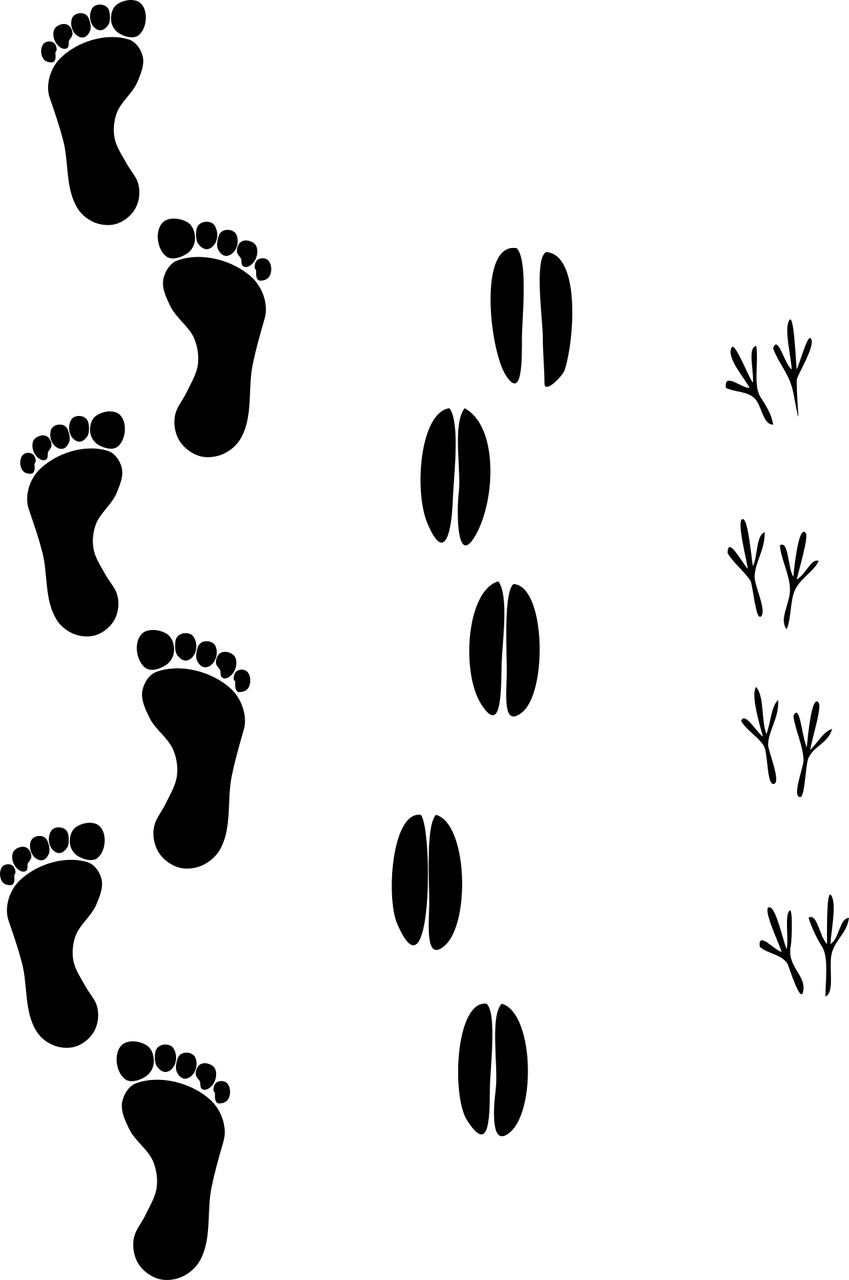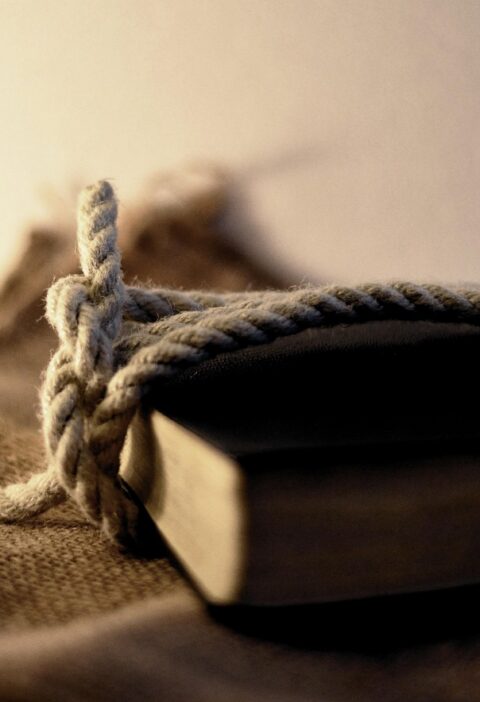|
EN BREF
|
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par l’élevage représentent une fraction significative des émissions mondiales, avec environ 14 % de l’ensemble des GES dont 60 % proviennent directement de cette activité. Parmi les principaux gaz responsables figurent le méthane (CH4), émis lors de la digestion des ruminants, et le protoxyde d’azote (N2O), lié à l’utilisation d’engrais. L’élevage contribue également à l’augmentation de CO2 par le transport et l’utilisation des machines. Malgré une baisse en Europe des émissions de méthane de 39 % entre 1990 et 2020, la concentration mondiale augmente, appelée à suivre des scénarios climatiques pessimistes. Des efforts en France et en Europe visent à atteindre une neutralité carbone d’ici 2050, notamment par l’amélioration des pratiques d’élevage et l’optimisation de l’alimentation des animaux, afin de réduire l’empreinte carbone tout en valorisant les services environnementaux que l’élevage peut offrir.
L’élevage constitue un secteur essentiel de notre alimentation, mais il est également un contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui soulève des inquiétudes quant à son impact sur le changement climatique. Environ 14 % des émissions mondiales de GES sont attribuées à l’agriculture, dont 60 % proviennent de l’élevage. Les principales sources d’émissions dans ce domaine incluent le méthane, le protoxyde d’azote et le gaz carbonique. Cet article propose une analyse détaillée des effets de l’élevage sur le bilan carbone de notre planète, en examinant les différentes sources d’émissions, les stratégies de réduction, et les implications pour la durabilité environnementale.
Les sources d’émissions de gaz à effet de serre dans l’élevage
L’élevage émet principalement trois types de GES : le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et le dioxyde de carbone (CO2). Le méthane est principalement produit par les fermentations digestives des ruminants, ainsi que par les effluents des animaux. Ce gaz a un pouvoir de réchauffement global environ 28 fois plus élevé que celui du CO2, bien que sa durée de vie dans l’atmosphère ne soit que de 10 ans comparé à 100 ans pour le CO2.
Le protoxyde d’azote est émis en raison de l’utilisation d’engrais, qu’ils soient organiques ou synthétiques, pour la production de l’alimentation animale. Enfin, les émissions de CO2 résultent principalement des transports, du chauffage des bâtiments d’élevage et des machines utilisées dans le secteur. Ainsi, une partie significative des émissions de GES dans l’élevage provient des matériaux et ressources importés pour l’alimentation des animaux.
Le constat des émissions de méthane dans l’élevage
À l’échelle mondiale, l’élevage est responsable d’environ 16 % des émissions de méthane. Bien que ces émissions aient diminué en Europe entre 1990 et 2020, la concentration de méthane dans l’atmosphère continue d’augmenter, ce qui pourrait augmenter le risque de réchauffement climatique. La nécessité de réduire ces émissions est donc cruciale, notamment par la mise en œuvre de pratiques durables.
Les stratégies françaises et européennes de réduction des émissions
La France et l’Union européenne voient la nécessité d’une stratégie concertée pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. La production animale peut contribuer à cet objectif par la gestion des stocks de carbone dans les sols et la réduction des émissions de GES par diverses mesures de régulation et d’amélioration des pratiques d’élevage.
Le rôle des pratiques d’élevage dans la réduction des émissions
La recherche sur l’efficacité de la production animale se concentre sur plusieurs leviers, y compris l’amélioration génétique, l’alimentation durable et l’amélioration des pratiques d’élevage. Par exemple, l’adoption d’aliments à faible émissions de carbone, ainsi que l’optimisation des régimes alimentaires, peut aider à réduire l’impact environnemental du secteur.
Le rôle de l’alimentation des animaux
L’alimentation représente un levier majeur pour réduire les émissions de GES dans l’élevage. Les aliments à faible bilan carbone, notamment pour les monogastriques comme les porcs et les volailles, sont particulièrement pertinents. Des outils comme Ecoalim permettent d’évaluer l’impact environnemental des rations alimentaires composées d’ingrédients divers. Cette évaluation est vitale pour concevoir des régimes alimentaires qui minimisent les émissions de GES tout en maintenant les performances des animaux.
L’importance économique et écologique des prairies
Les prairies permanentes jouent un rôle crucial dans le stockage du carbone et dans le maintien de la biodiversité. Elles contribuent non seulement à atténuer les émissions, mais fournissent également des services écosystémiques tels que la fertilisation naturelle des sols et la conservation des habitats. Cependant, la pression exercée sur les terres agricoles peut menacer cette dynamique positive.
Les défis de la spécialisation régionale dans l’élevage
La spécialisation régionale en matière d’élevage peut entraîner des surcharges d’effluents, qui, lorsqu’elles ne sont pas gérées correctement, contribuent à la pollution des nappes phréatiques et des rivières. Cela accentue la nécessité d’une distribution plus équilibrée des types de production animale pour réduire les impacts environnementaux locaux.
Innovations et recherches dans le domaine de l’élevage durable
Des projets de recherche tels que le programme METHANE 2030 visent à développer des solutions multi-leviers pour réduire les émissions de méthane. Cela comprend des innovations techniques, telles que des stratégies alimentaires ciblées et l’amélioration génétique des animaux, pour maximiser leur efficacité tout en réduisant les déchets.
Au fur et à mesure que les préoccupations relatives au changement climatique augmentent, la nécessité d’évaluer et d’atténuer l’impact carbone de l’élevage devient d’autant plus pressante. Des initiatives à l’échelle nationale et européenne doivent être mises en œuvre pour garantir la durabilité de l’élevage, tout en répondant aux besoins alimentaires croissants de la population mondiale. En fin de compte, la recherche et l’innovation dans ce secteur seront les clés de l’avenir de l’élevage et de la santé de notre planète.
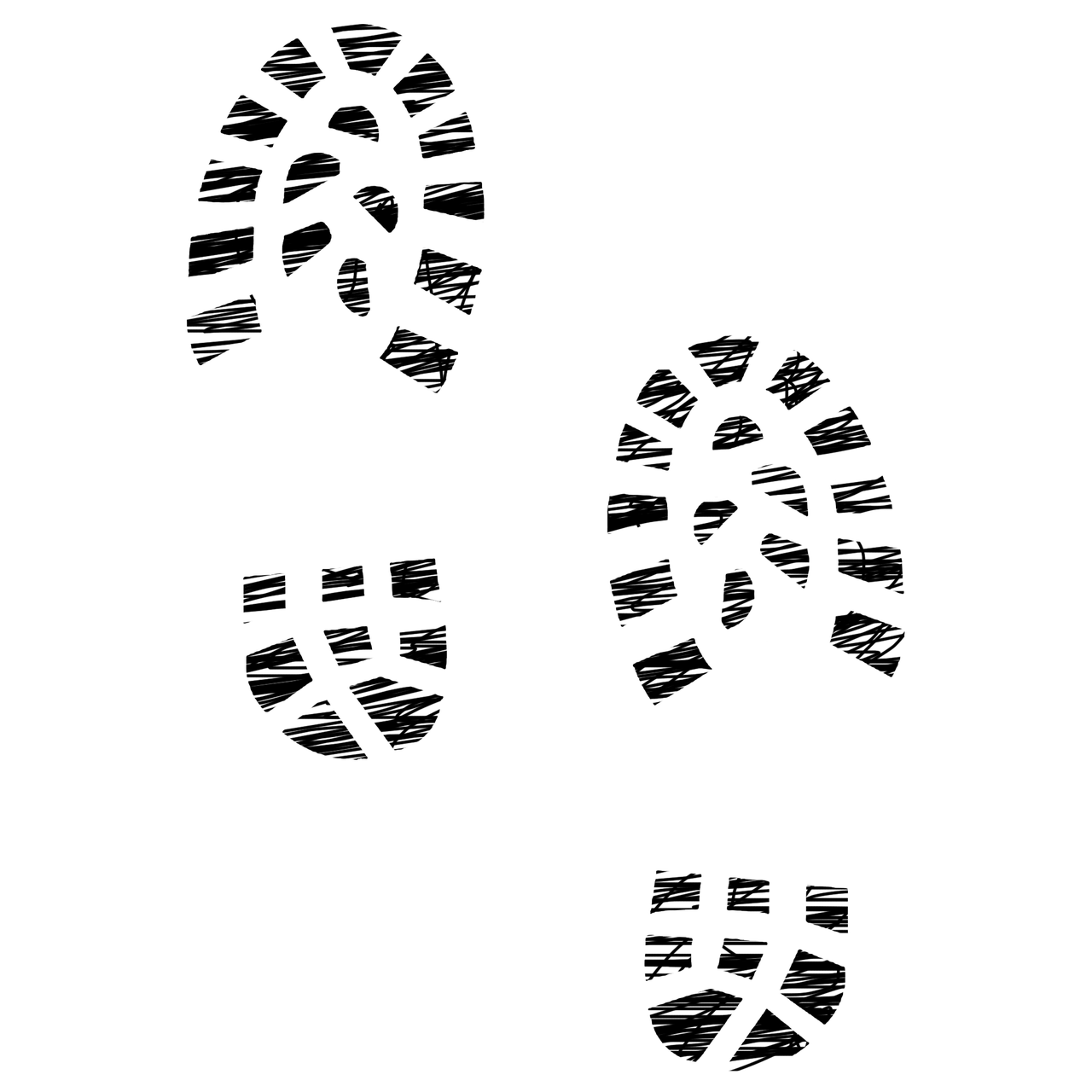
Les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) résultant de l’agriculture atteignent 14 %, dont une part considérable de 60 % provient spécifiquement de l’élevage. Dans ce secteur, le méthane (CH4) s’érige comme l’un des contributeurs majeurs, notamment en raison des fermentations issues de la digestion des ruminants. Facteur aggravant, la durée de vie du méthane dans l’atmosphère est bien plus courte que celle du dioxyde de carbone (CO2), mais son pouvoir de réchauffement est environ 28 fois plus élevé.
La recherche indique que l’élevage est responsable de 16 % des émissions mondiales de méthane. Malgré cela, des efforts notables ont été observés, notamment en Europe, où les émissions de méthane ont diminué de 39 % entre 1990 et 2020. Il est essentiel que des mesures soient mises en place pour réduire encore ces émissions, surtout au niveau mondial où la concentration de méthane continue d’augmenter.
En France, les initiatives visent à réduire les émissions de méthane à travers l’amélioration des pratiques d’élevage. Par exemple, le programme METHANE 2030 ambitionne de réduire ces émissions de 30 % au cours de la prochaine décennie, en adoptant des stratégies qui touchent à la sélection génétique, à l’alimentation et à l’efficience des animaux. Cela met en lumière l’importance d’une transformation du système d’élevage pour minimiser son impact environnemental.
Les services environnementaux offerts par les systèmes d’élevage extensifs ne doivent pas être sous-estimés. Les prairies, par exemple, jouent un rôle fondamental dans le stockage du carbone, et elles sont menacées par une spécialisation excessive et par la conversion à des cultures plus intensives. Conserver ces prairies pourrait non seulement aider à la réduction des émissions de GES, mais également préserver biodiversité et fertilité des sols.
Un autre axe d’action demeure l’alimentation des animaux. Utiliser des ressources non comestibles pour l’homme et optimiser les aliments à faible bilan carbone représente un levier crucial pour limiter les GES. Des outils comme Ecoalim, développés par INRAE, permettent d’évaluer le bilan carbone de l’alimentation animale et d’encourager les fabricants à opter pour des formulations plus durables.
Enfin, le rôle de la génétique est déterminant. Les sélections génétiques s’accompagnent de travaux innovants autour de l’épigénétique, permettant de mieux comprendre l’impact de l’environnement sur les animaux d’élevage. Ce savoir pourrait déboucher sur des pratiques optimisées avec des animaux moins émetteurs de méthane, contribuant ainsi à une réelle évolution vers un élevage plus durable et respectueux de l’environnement.